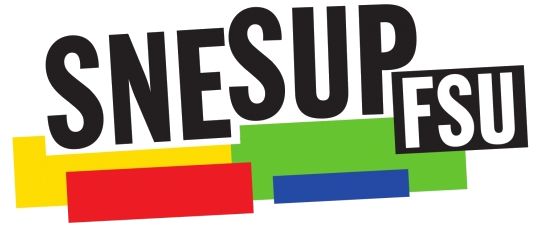| A l'UB | Liens |
| Dossiers | FAQ |
| Nos élus | Agenda |
| Contacts | Ailleurs |
Dans la foulée de ses promesses de campagne, le président de l’université de Bourgogne a lancé une consultation sur la pédagogie et les formations dans notre établissement. En décembre 2020 a ainsi été annoncé le lancement des « États Généraux de la formation », bien évidemment en ligne, sous la forme d’un questionnaire internet, avec comme objectif de « définir la politique de formation de l'établissement et révéler les réalisations et expérimentations pédagogiques réalisées à l'uB ».
Ce type d’initiative vise sans doute à promouvoir des échanges entre l’équipe de la présidence et les personnels, échanges utiles dans un contexte d’atomisation et d’individualisation accrues par les effets de l’enseignement à distance. Toutefois, la forme du questionnaire, le langage qui y est mobilisé, construit de façon très binaire et opposant ce qui « soutient » et ce qui « entrave » nos visions de la formation, nous a semblé à la fois très caricatural et simpliste, en tous les cas incapable de répondre aux enjeux actuels que soulèvent les questions de formation. Ainsi, parmi les questions posées, on peut lire celles-ci, formulées avec majuscules : « dans votre quotidien à l’uB, quelles PRATIQUES PEDAGOGIQUES SOUTIENNENT votre vision d’une formation universitaire répondant à vos attentes ? et quelles PRATIQUES PEDAGOGIQUES ENTRAVENT votre vision d’une formation universitaire répondant à vos attentes ? »...
Depuis une vingtaine d’années, la démocratie et le débat se réduisent de plus en plus à des consultations « citoyennes » hors-sol censées montrer l’intérêt des gouvernants pour l’avis de la population. Les consultations, États Généraux et autres débats publics prolifèrent ainsi dans tous les domaines. Peu satisfaits de la forme du questionnaire, de la nature même des questions proposées, qui encadre la réflexion et réduit les marges d’expression, nous faisons le choix de transmettre cette contribution collective pour rappeler nos projets, visions, et perspectives en matière d’enseignement et de pédagogie.
- 1. La question des compétences
- 2. Les menaces et illusions du tout-numérique
- 3. La formation des enseignants entre incertitudes et crises
- 4. La question des postes, inséparable du problème de la précarité
- 5. L'accueil des étudiant.e.s étranger·ères
- 6. Conclusion
En continuité avec les précédentes réformes, le dernier arrêté Licence introduit la découpe de nos formations en « blocs de compétences ». Bien que cette déclinaison des formations en termes de compétences ne soit pas nouvelle (toutes les formations inscrites au RNCP ont déjà cette obligation, en particulier celles ouvertes en alternance), la « nouveauté » est que certains présentent l’approche par compétences et la construction des formations par blocs de compétences comme étant la solution pour améliorer la réussite des étudiants. L’argumentaire qui a prévalu pour cette réforme confond la pratique pédagogique (l’approche par objectifs et apprentissages), qui doit rester propre à chaque enseignant·e, et la construction de la formation (blocs de compétences). Ce n’est pas innocent, et c’est une modification fondamentale de notre métier. Penser une formation en blocs de compétences fait passer les enseignant·es du statut de « transmetteur de connaissances » ou « transmetteur de savoir disciplinaire » à celui de « facilitateur d’apprentissage » : la nuance est très importante.
Pourtant, l'approche par compétences a déjà été testée depuis de nombreuses décennies au Québec, en Belgique et en Suisse, avec des résultats plus que mitigés et des preuves de sa dangerosité, notamment par la perte des savoirs dont elle s’accompagne1. L’introduction de la pédagogie par compétences dans le secondaire a des conséquences d’ores et déjà visibles sur nos étudiant·es, induisant des difficultés particulièrement inquiétantes dans certaines disciplines.
Au-delà du choix de la pédagogie par compétences, qui ne devrait relever que de la seule liberté pédagogique des enseignant·es du supérieur, la construction des formations par « blocs de compétences » induit un changement de paradigme fondamental, en passant d’une logique de diplomation à une logique de certification. Encourager les étudiant·es à quitter les études sans diplômes mais avec des certifications est ainsi un moyen pour l’État de faire des économies. L’« avantage » des blocs de compétences est en outre de pouvoir vendre des certifications à des salarié·es en leur faisant payer quelques heures d’enseignement. Les entreprises n’auraient ainsi plus à leur charge des frais de formation intégrale.
Si on ne voit pas en quoi les blocs de compétences améliorent l’acquisition de savoirs par les étudiant·es, on voit très clairement comment ils participent à la construction du marché de la formation et à l’individualisation des parcours, creusant toujours plus les inégalités. Avons-nous vraiment envie de nous engouffrer, docilement, dans cette logique ?
La période de pandémie que nous continuons à vivre a considérablement renforcé l’emprise des outils et pratiques numériques dans nos imaginaires et dans nos quotidiens d’enseignant·es-chercheur·euses. Les budgets et les injonctions à s’équiper se sont multipliés à la faveur de la crise sanitaire, le numérique a été présenté comme la condition de la « continuité pédagogique », alors que l’université a été parmi les sacrifiés sur l’autel de la sécurité sanitaire.
Les pouvoirs publics nationaux et régionaux comme les instances centrales de notre université relaient massivement, et cela depuis plusieurs années désormais, les promesses et arguments publicitaires à propos de la « pédagogie numérique », souvent reprises sans aucune distance critique des énoncés produits par les acteurs économiques du secteur, start-up ou Gafam de la « Ed-Tech » (Educational Technology) selon le jargon qui tend à s’imposer.
Le numérique est devenu en 2020 l’alpha et l’oméga de l’enseignement, accentuant des tendances antérieures. Collecte des informations, diffusion de la recherche, mise en réseau, le numérique remodèle le quotidien et les pratiques de l'enseignement supérieur et de la recherche. Mais il n’est pas un outil neutre, et ce qu’on appelle numérique recouvre une grande diversité d’artefacts qui impliquent des choix, des modes de classement et de hiérarchisation, des algorithmes produits par des acteurs industriels dont l’agenda a peu à voir avec celui des besoins pédagogiques et de la réflexion critique. Il faudrait prêter une attention accrue aux pratiques réelles comme aux nouveaux pouvoirs et aux nouvelles formes de domination qui accompagnent le mouvement, et questionner les choix de notre université de s’en remettre si massivement à des logiciels payants fournis par les Gafam comme Microsoft Teams….
Il serait sans doute absurde de repousser par principe le « numérique éducatif et pédagogique », mais il l’est tout autant de s’en remettre naïvement et sans réflexions critiques à ces outils et langages qui remodèlent nos pratiques enseignantes via des injonctions qui viennent majoritairement d’en haut. Nous ne voulons pas céder aux injonctions permanentes portées par des discours trop abstraits, de ne pas accepter sans débats de renoncer à des pratiques éprouvées au nom d’innovations vendues comme inéluctables. L’enjeu est de penser les artefacts, leurs conditions de fabrication et d’usage, les discours qui les portent et les installent au quotidien comme une nécessité. Depuis quinze ans, la promotion spectaculaire de l’université « numérique » autorise à parler sans complexe d’industrialisation de la formation et de la recherche grâce aux nouveaux outils. Le numérique accompagne aussi la réactivation d'un discours fataliste qui identifie le progrès, la technique et le marché. L’Université devrait selon nous être un espace réflexif, qui interroge ces évolutions sans céder aux idéologies du moment. À l’heure des débats sur la crise climatique et environnementale, peut-on continuer à promouvoir ces outils et le distanciel sans interroger l’accroissement de consommation énergétique nécessité par les nouvelles infrastructures du Net, sans penser les conditions sociales et matérielles de fabrication et de (non-)recyclage des objets et des réseaux ?
Est-il dans notre intérêt de passer sous silence le coût exorbitant de tous ces équipements dans un contexte de surconsommation de ressources et d’énergie, de pollution généralisée, de reproduction ou d’aggravation des inégalités spatiales et sociales, de surveillance algorithmique généralisée, d’épuisement des psychismes sous l’effet de l’accélération ? De plus en plus d’études montrent que les investissements réalisés dans ce domaine n’ont dans le meilleur des cas qu’une « incidence mitigée sur la performance des élèves » et aucune amélioration sensible n’est enregistrée sur les performances scolaires, comme l’indiquait dès 2015 un rapport de l’OCDE2, confirmé depuis par d’autres.
La crise épidémique de 2020 a révélé les insuffisances d’une pédagogie modelée par le numérique et ses promesses, elle a montré les inégalités étudiantes à cet égard, révélé les apories de formations fascinées par la puissance des outils techniques et qui oublieraient l’importance de l’échange réel. Nous avons besoin d’enseignement, de salles de cours, d’espaces où puissent se déployer la parole et l’échange, bien plus que de Mooc, de nouveaux logiciels vite périmés, ou de procédures automatisées qui annoncent la mort de nos métiers.
Les États Généraux de la formation sont lancés à l’uB alors même que le ministère de l’Éducation nationale met en œuvre à marche forcée, sans tenir aucun compte des principales demandes de nos organisations syndicales,une réforme de la formation des futur·es enseignant·es, qui préoccupe légitimement de nombreux collègues impliqué·es dans les Masters Meef et l’INSPE. Beaucoup d’entre nous se trouvent actuellement réduits à devoir appliquer à la hâte, en pleine crise sanitaire, des décisions venues du MEN avec lesquelles ils sont en désaccord. Cette nouvelle réforme du Master enseignement mais aussi des concours d’enseignement des 1er et 2nd degrés fait pourtant l’unanimité contre elle, à tel point que le ministère avait dû la suspendre en février 2020. Elle doit néanmoins entrer en application dès la rentrée universitaire 2021-2022. Plusieurs communiqués intersyndicaux mais aussi des tribunes et prises de parole collectives de responsables de ces formations ont déjà alerté sur le « sacrifice délibéré du savoir, de la connaissance et d’une démarche cohérente de professionnalisation au profit d’une conception précarisée de la formation et du métier de professeur ».
Alors que jusqu’ici les étudiant·es préparaient leur concours (CRPE, CAPES, CAPET, CAPLP, CAPEPS, CPE) dans la première année du Master, avant de devenir, en seconde année, fonctionnaires-stagiaires bénéficiant d’un salaire mensuel de 1 400 euros nets, les futurs enseignant·es prépareront désormais le concours tout au long des deux années de leur Master. Elles/ils seront sélectionné·es au terme de la deuxième année durant laquelle elles/ils devront à la fois étudier de lourds programmes, préparer un mémoire de recherche, apprendre à maîtriser un métier de plus en plus exigeant et faire un stage sous le statut de contractuel·le pendant une année scolaire qui ne leur vaudra que 865 euros bruts par mois ! Cette situation découragera encore davantage les étudiant·es à se présenter à un concours de moins en moins attractif, et elle aura aussi des conséquences désastreuses pour les élèves, qui auront pour enseignant·es ces étudiant·es-professeur·es stagiaires débutant·es et débordé·es.
La formation des futur·es enseignant·es est un aspect essentiel du travail des universitaires car ce sont elles et eux qui devront faire le lien entre l’université et les publics écoliers. Nous regrettons donc amèrement la perte massive et inquiétante de formation académique, tout comme l’injure faite à l’Université, réduite à « s’adapter » et à répondre aux injonctions et demandes d’un ministère qui n’est pas le sien en perdant toute autonomie pédagogique. Comme nos organisations syndicales l’ont déjà souligné, ces projets de réforme ne feront qu’aggraver une tendance générale à la précarisation des jeunes et au transfert du coût des études sur les individus, au risque d’un effondrement des viviers étudiants, la crise sanitaire et économique actuelle accroissant encore ces risques. Pour nous, il faut au contraire déprécariser en finançant les études, notamment par des prérecrutements, ce qui sécurisera le temps nécessaire à la formation tout en contribuant à l’attractivité de nos métiers.
La réforme qui s’annonce est très loin de répondre aux attentes des « actrices et acteurs de terrain », selon l’expression désormais consacrée, et les politiques de nos établissements ne sauraient se réduire à accompagner et appliquer passivement ces réformes gouvernementales faites à la va-vite, quoiqu’elles procèdent de logiques et projets anciens. Si le ministère fait des économies sur l’année de stage des futur·es professeur·es, il en fait également sur les formations, les volumes d’heures consacrés à la maîtrise des connaissances dans les diverses disciplines en Master étant drastiquement revus à la baisse. Pour toutes les disciplines représentées aux concours d’enseignement, cette réforme induira un affaiblissement de la formation des futur·es enseignant·es, au profit d’une sorte de savoir-être et d’une pseudo-professionnalisation de moins en moins ancrée dans les savoirs tels qu’ils se construisent et s’enseignent à l’université. Cette réforme a été lancée pour uniformiser les modalités de formation, avec l’idée sous-jacente – et qui transparaît aussi dans les politiques de soi-disant « innovation pédagogique » menées au sein de l’uB - que ces dernières seraient en quelque sorte interchangeables : en témoigne par exemple la mise en place d’un nouvel oral, entretien de motivation devant le jury, qui sera nécessairement formaté et qui prendra la place d’une épreuve scientifique et didactique appelant un travail de réflexion.
Cette réforme, particulièrement complexe et opaque dans ses modalités concrètes, accroît par ailleurs les fragiles équilibres que les différents intervenants de la formation avaient tenté d’instaurer dans les dernières années. Au nom d’une professionnalisation entendue de manière restrictive comme un apprentissage de « bonnes pratiques » plus que comme une démarche réellement réflexive sur les enjeux du métier, l’approfondissement des connaissances disciplinaires et didactiques, la formation à l’esprit critique, l’acquisition d’une culture générale sont littéralement sacrifiés. Il s’agira désormais et de plus en plus de former des technicien·nes de l’enseignement, à qui l’on demandera simplement de restituer un savoir officiel dûment contrôlé. Nous contestons fortement cette vision de l’enseignement et l’approche très centralisée imposée verticalement à travers de pseudo-consultations, alors même que l’avis des étudiant·es, des futur·es enseignant·es, des actrices et des acteurs de leur formation a largement été ignoré.
Ces États Généraux de la formation sont également l'occasion de rappeler que l'Université fonctionne avant tout grâce à ses personnels : enseignant·es-chercheur·euses, mais aussi personnels BIATSS, qui font tourner les formations. Or ces dernières années, le nombre de postes de titulaires a dramatiquement diminué, alors même que les effectifs étudiants sont en constante augmentation. Des personnels embauchés en CDD ne sont pas renouvelés alors même que leurs missions sont pérennes, contraignant ainsi leurs collègues à prendre en charge la formation de nouvelles personnes, ce qui alourdit leur propre charge de travail. Une telle gestion est ubuesque et totalement contreproductive. Les économies de court terme (réalisées en n'embauchant pas de titulaires) ne prennent pas en compte la charge de travail des différents personnels.
En ce qui concerne les enseignements, le constat est affligeant. À l'université de Bourgogne, ce sont globalement 29% d’enseignants contractuels, avec des disparités importantes selon les départements (les sciences humaines et sociales étant les plus touchées). Alors que ce statut devait permettre à des professionnels de dispenser quelques heures d'enseignements dans leur domaine de spécialité, il sert aujourd'hui à pallier le manque de moyens à l'université. Rouage essentiel du fonctionnement des formations dans certains départements, les vacataires travaillent dans des conditions indignes : sans contrat de travail pendant plusieurs semaines à plusieurs mois, payé·es deux fois dans l'année, ou au mieux pas avant janvier pour des cours donnés en septembre — le tout pour une rémunération inférieure au SMIC horaire. Les vacataires sont un symptôme du manque de considération de l'institution pour ces personnels : ils sont les variables d'ajustement du système universitaire appelé à toujours plus de flexibilité. Si l'université de Bourgogne n'est pas seule en cause dans cette pénurie de postes, il importe de questionner les choix qui sont opérés par la présidence dans les marges de manœuvre dont elle dispose : or, bien souvent la responsabilité est rejetée sur la COMUE ou le Ministère. Finalement, la présidence dresse le portrait d’une « gouvernance » paradoxalement sans pouvoir. A minima, plus de transparence dans les prises de décisions pourrait être un début dans la gestion de cette pénurie. Et au niveau local, des possibilités existent pour faire en sorte que les vacataires qui assurent plus de 64h de cours touchent un salaire au moins tous les deux mois. C'est en effet un secret de polichinelle que ces vacations servent à financer bon nombre de doctorant·es qui n'ont pas ou peu de financement pour leurs recherches et de docteurs sans postes, qui plus est dans la situation sanitaire actuelle.
Ce sont ces doctorant·es et docteur·es qui, au même titre que leurs collègues titulaires, contribuent au développement des connaissances et des savoirs de l'université. La différence entre eux : bien souvent les premier·ères travaillent gratuitement, lorsque leurs thèses ne sont pas financées. Aujourd'hui notre plus vive inquiétude va vers nos étudiant·es. Quelle université leur présentons-nous ? Voulons-nous vraiment leur donner en spectacle la précarité du système universitaire français ? Ses carences ? Ces étudiant·es sont les collègues de demain. Voulons-nous vraiment les envoyer ailleurs : Lyon, Besançon, Paris, Londres, Berlin ? Si nous restons sur cette trajectoire, quel sort réservons-nous à notre passion pour ce métier que nous aspirons à leur transmettre ?
Comme sur la plupart des points précédents, la crise sanitaire que nous traversons a servi de révélateur à certaines faiblesses structurelles de notre système de formation. C’est particulièrement net lorsqu’on examine la situation des étudiant·es étranger·ères - pas tant celles et ceux que nous accueillons dans le cadre de conventions internationales, qui garantissent l’appui de l’Université d’origine, mais bien celles et ceux qui viennent « à titre individuel », bien souvent des Suds. De remarquables structures d’accueil et d’accompagnement existent, mais elles sont très loin de concerner l’ensemble des arrivant·es. Beaucoup, malgré les efforts du Service des Relations internationales et des enseignant·es responsables, se sentent livrés à eux-mêmes. Les arrivées souvent tardives, en raison de la distribution erratique des visas, renforcent le sentiment d’isolement, peu favorable à l’intégration dans des réseaux de travail en commun. Même lorsque les étudiant·es sont originaires de pays officiellement francophones, le niveau de langue requis par nos enseignements et exercices semble souvent hors de portée (surtout dans les disciplines littéraires). Dès qu’une situation particulière impose le recours à des instruments de travail coûteux, on mesure un sous-équipement criant. Pour couronner le tout, la politique sécuritaire de l’administration française suscite chez les titulaires de cartes de séjour temporaires une crainte qui les empêche de s’ouvrir de leurs difficultés.
Il semble nécessaire de réfléchir à des procédures d’accompagnement spécifique pour introduire efficacement les étudiant·es étranger·ères aux méthodes de l’enseignement supérieur à la française. Sans cela, les taux d’échec trop élevés que l’on constate en bien des secteurs se perpétueront, au point de conduire les équipes pédagogiques à se demander s’il est bien raisonnable d’accueillir encore des candidat·es à qui nous devrions offrir une vraie chance de promotion, mais pour qui les conditions d’étude et d’évaluation sont trop souvent faussées d’avance.
Derrière les affichages et les promesses, la formation et la pédagogie sont les oubliées des politiques publiques, ramenées à des enjeux techniques, aux sciences cognitives et aux outils numériques, de plus en plus promus comme les principales réponses à apporter aux défis pédagogiques contemporains. Contrairement à ce qu’affirment les messages de communication et vidéos envoyés dernièrement à toute la communauté universitaire pour vanter l’initiative, ces États Généraux de la formation ne nous semblent guère « historiques » . Comme d’autres, notre établissement s’est doté d’un « Centre d'Innovation Pédagogique » - c’est d’ailleurs lui qui pilote l’organisation de ces États Généraux. Ce CIPE évalue beaucoup. Mais qui évalue le CIPE, son utilité, sa pertinence, sa capacité d’aide et de soutien ? C’est moins d’« innovation » dont nous avons besoin que de temps, de personnels et de lieux vivants nous permettant d’échanger avec nos étudiant·es et collègues, de leur transmettre notre passion pour les savoirs critiques seuls à même de nous aider à construire le monde de demain. Au lieu de nous envoyer des courriels et des injonctions vantant, par exemple, les mérites des « approches par compétences » ou les dernières modes numériques sur le « Learning Design », donnez-nous les moyens d’enseigner nos disciplines, de partager avec les étudiant·es nos recherches et nos questionnements, en respectant les spécificités de chaque discipline et la liberté pédagogique des enseignant·es-chercheur·euses !